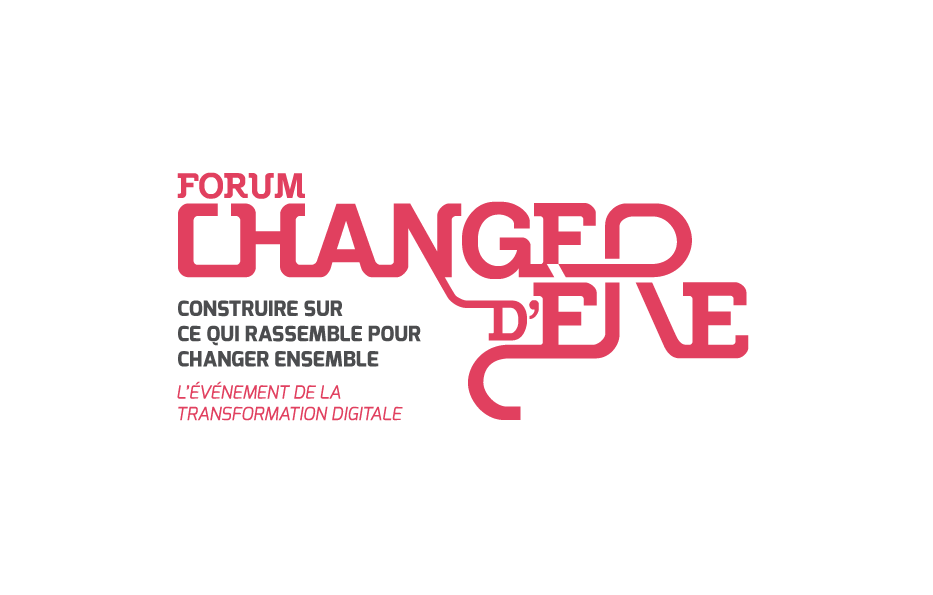Véronique Anger : Quelle est votre définition des droits de l’Homme ?
Historien, diplomate, homme de théâtre, écrivain, *Marc Agi est tout cela à la fois. En 1964, alors qu’il n’a que 28 ans, il rencontre René Cassin(1), compagnon de la Libération et grand défenseur des droits de l’Homme. Cette rencontre va marquer un tournant décisif dans son existence. Il lui consacrera plusieurs ouvrages(2) dont un doctorat d’État sur sa vie et son œuvre.
Depuis 2001, Marc Agi préside l’Académie Internationale des Droits de l’Homme(3). N’appartenant à aucune école de pensée, à aucun parti politique, à aucun courant religieux, à aucun mouvement syndical, il essaie -selon ses termes- « de rendre, tout simplement, la parole à l’Homme ».
Marc Agi: Pour ceux qui croient en l’existence de la transcendance, les droits fondamentaux puisent leur source dans les « droits naturels », œuvre de la divinité. L’Homme est créé par Dieu et, de ce fait, possède une part de sacré (l’Homme créé à l’image de Dieu) qu’il faut préserver. Cette définition est parfaite si vous êtes croyant. Si vous ne l’êtes pas – qui que vous soyez et où que vous soyez – vous avez également droit au respect de vos droits fondamentaux. La notion de droits de l’Homme est, en quelque sorte, une laïcisation des droits naturels.
Mais il existe plusieurs doctrines juridiques sur les droits de l’Homme. Celles-ci restent évidemment hors de portée des citoyens ordinaires, tout au moins de ceux qui n’ont jamais vraiment eu la possibilité de s’adonner au droit. Selon la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, l’expression « droits de l’Homme » a acquis un sens philosophique et politique précis : » Elle recouvre l’affirmation des droits individuels dans un rapport à l’État, à la société et au système socio-économique. Elle n’exclut pas la diversité des cultures. La Déclaration universelle des droits de l’Homme marque clairement l’universalité et l’unicité des droits, civils, politiques, sociaux, culturels et économiques « .
VA : Cette définition peut-elle varier d’un pays à l’autre ?
MA : Quels que soient sa culture et son lieu de vie, l’Homme a droit au respect de ses droits et libertés fondamentales (même si ceux-ci comportent une large part d’affectivité et de subjectivité). Il s’agit d’un droit universel. Comme j’essaie de le montrer dans mon livre(4), l’Homme avec un grand « H » est un être à trois dimensions, essentielles et concomitantes : l’espace, le temps, le langage – à la différence des animaux qui ne possèdent pas de langage au sens culturel ou technologique. Ainsi, chaque être humain vit dans un lieu qui lui est propre, accomplit au cours de son existence un certain nombre de gestes nécessaires à sa survie, tout en ayant la faculté de comprendre les autres (ou de ne pas les comprendre). Conscient en tout cas de leur existence et de leur égale dignité, il est personnellement concerné dans sa vie et sa chair par la mise en œuvre et le respect des droits de l’Homme.
VA : » De nos jours, nul n’a le droit de ne parler que du haut de lui-même(…). Il serait plus prudent avant d’ouvrir la bouche, de se mettre en conformité avec une entité quelconque, comme si conformité était synonyme de légitimité « . Vous regrettez que les individus ne puissent s’exprimer que s’ils possèdent une » légitimité « . De quelle légitimité parlez-vous ?
MA : Je pense que le simple fait d’être un citoyen ordinaire constitue en soi une légitimité. C’est justement parce que chacun représente le » premier venu » comme je le nomme, qu’il est légitime. Si on se présente comme appartenant à une corporation, une association, une » chapelle » de pensée, on exprime le message de son groupe. Mon interlocuteur va alors me « cataloguer » comme médecin, comme professeur, comme chrétien, comme juif, musulman,… et interprétera mes paroles dans ce contexte, c’est-à-dire : en conformité avec une entité bien identifiée. C’est pourquoi j’oppose le discours des groupes à la parole des hommes (les » premiers venus « ).
Dès lors que l’on souhaite contribuer au bien commun, œuvrer pour l’éthique des droits de l’Homme, le problème de la légitimité se pose. De quel droit travaille-t-on dans son coin pour le « bien » des autres ? Si chacun attend de recevoir une légitimité élective ou associative pour agir, rien ne se produira. À travers mon livre, j’essaie de montrer que, chacun étant le premier venu, il a un rôle à jouer. Or, les opportunités d’améliorer les libertés, notamment dans le cadre de son travail, sont multiples. Je pense en particulier à toutes les professions que j’appelle « à éthique » (médecins, avocats, policiers, enseignants…) parce qu’elles s’exercent directement sur la personne humaine, quelle qu’elle soit, où qu’elle se trouve.
À chaque « profession à éthique » correspond un droit fondamental qu’elle a pour mission de promouvoir et de défendre. Exercer sa pratique sur la personne humaine revient en effet à mettre en œuvre certains droits fondamentaux : l’accès aux soins, à l’éducation, le droit à la justice, à l’information… Par conséquent, si chacun exerce » éthiquement » son métier, il peut se rendre universellement utile et, ainsi, contribuer au bien commun sans cesser d’être le premier venu.
VA : Est-il politiquement possible d’envisager une application éthique des droits de l’Homme à travers ces professions, et dans le monde entier ?
MA : Je ne pense pas que cela soit utopique. En effet, si tous les professionnels possédaient la même éthique, le monde progresserait sans doute beaucoup plus rapidement. Ce n’est pas une question d’identité culturelle, mais d’éthique universelle, et surtout de pratique.
Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j’avais été sollicité pour organiser une formation aux droits de l’Homme dans un pays d’Amérique latine que je ne citerai pas. Le public était uniquement composé de policiers. Comme vous le savez, la police de certains pays a la fâcheuse réputation de dégainer avant de dire bonjour – en particulier à l’occasion de manifestations de rue. Dans ce contexte un peu difficile, je me suis demandé quelle serait la meilleure façon de leur parler des droits de l’Homme.
J’ai alors demandé à des policiers français, spécialistes de la répression « douce », de venir m’assister. Leurs pratiques « professionnelles » permettent en effet de disperser les manifestants sans tuer. Si cette technique fonctionnait en Europe, elle pouvait aussi donner de bons résultats dans d’autres pays. C’est ce qui a été fait, et nos enseignants policiers ont réussi à sensibiliser l’auditoire au respect de la vie humaine sans, à aucun moment, avoir à prononcer l’expression « droits de l’Homme ».
Quelques mois seulement après cette formation, une manifestation eut lieu dans le pays. La foule, réprimée par les policiers qui avaient suivi le stage, n’a subi aucune perte. En revanche, on a comptabilisé 34 morts du côté des manifestants réprimés par les troupes de gendarmes utilisant leurs techniques habituelles. Même si l’on est impuissant, politiquement, à faire respecter les droits de l’Homme dans un pays, cette illustration est la preuve que la compétence technique dans l’exercice d’une profession à éthique permet de progresser, ne serait-ce que grâce à la préservation des vies – ce qui est primordial quand on s’occupe de droits de l’Homme. Je pense que cette démonstration est valable pour toutes les professions à éthique et applicable aux quatre coins de la planète.
VA : Dans un livre à paraître en 2007 » L’Homme univers » (4) vous apportez également quelques précisions sémantiques, en particulier au sujet des droits de l’Homme et des » droits-de-l’hommisme « , et dénoncez les » saboteurs de vocabulaire « . Aurions-nous perdu le sens et la valeur des mots ?
MA : On doit la première Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen à la Révolution française. La Déclaration d’Indépendance des États-Unis, qui est de 1776, est plutôt l’expression d’une décolonisation et ne parle pas de l’Homme universel, celui avec un grand « H » qu’évoque la Déclaration de 1789. On n’y trouve pas non plus la notion d’indivisibilité des droits de l’Homme, qu’on trouvera plus tard dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (universalité des droits civils et politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels). Ce sont les doctrines socialistes et le marxisme qui les premiers, au milieu du XIXe siècle, ont défini les droits économiques et sociaux, en déclarant que l’homme ne devait pas être exploité par l’homme. C’est d’ailleurs pour cette raison que les défenseurs des droits de l’Homme ont longtemps été étiquetés « de gauche ».
Avec le temps – et beaucoup de travail – tout le monde a fini par accepter l’idée d’une indivisibilité des droits de l’Homme dans ses aspects à la fois civils et politiques, mais aussi économiques et sociaux. En dépit de cela, certains, ceux que j’appelle volontiers les « saboteurs de vocabulaire » – généralement quelques détracteurs plus maladroits que malintentionnés – critiquent la doctrine même des droits de l’Homme, en essayant de faire croire qu’il s’agit d’une simple idéologie. Ce sont ceux qui parlent de « droits-de-l’hommisme ». Or, les droits de l’Homme sont tout sauf une idéologie, puisque leur but est de nous protéger contre toutes les idéologies. Cette expression de droits-de-l’hommisme est, à mon sens, caricaturale de ceux qui l’utilisent…
VA : Vous proposez de « constituer la parole humaine » en fondant une « Organisation des peuples unis,(…) sorte de conscience de l’humanité » pour pallier « la mondialisation économique, la fossilisation des partis politiques traditionnels et la démobilisation des citoyens ». Comment y parvenir sans verser dans la politique ou l’idéologie ?
AV : C’est en cela que mon entreprise peut paraître difficile et même périlleuse. J’interpelle chaque citoyen en lui demandant ce qu’il fait pour contribuer au respect de l’éthique des droits de l’Homme et du bien commun. Je ne lui demande pas de s’inscrire à un mouvement associatif ou politique. Comme disait René Dumont(5) : « Il faut que chacun, dans son coin à son niveau, fasse ce qu’il y a à faire ».
VA : Œuvrer chacun à son niveau pour le bien commun de l’humanité, est-ce votre définition de » l’Homme Univers » ?
MA : En vérité, « l’Homme « » est une représentation de la conscience de l’humanité. L’Homme Univers est seulement à l’état d’idéal commun, car il n’existe encore aucun réel mouvement universel, sorte de société civile internationale suffisamment organisée, pour pouvoir exercer une influence positive sur la marche du monde. Pourtant, il me semble plus qu’urgent d’œuvrer à la constitution d’une « citoyenneté universelle ». Faire pression sur nos élus pour qu’eux aussi obéissent à une éthique des droits de l’Homme et contribuent de cette manière au progrès du bien commun, mais aussi nous inciter les pouvoirs publics à faire avancer le droit international, tant du point de vue du respect des droits civils et politiques que de celui des droits économiques, sociaux et culturels – notamment par la mise en œuvre effective de la Cour pénale internationale.
VA : Vous constatez que la dénonciation systématique des violations des droits de l’Homme « peut avoir pour conséquence inattendue l’assoupissement des consciences ». En somme, vous craignez que trop d’horreur ne banalise l’horreur… Les médias doivent-ils cesser de montrer la souffrance des hommes ? Que faut-il faire alors ?
MA : La mission d’une presse libre consiste à débusquer les violations où qu’elles se produisent. D’ailleurs, La Cour européenne des droits de l’Homme attribue à la presse un rôle de « chien de garde de la démocratie ». J’observe simplement qu’il existe un réel décalage entre l’information et, parfois, le plaisir malsain que certains éprouvent parfois au spectacle de l’horreur.
À mon sens, il existe deux façons de lutter pour les droits de l’Homme : dénoncer les violations, certes, mais aussi se battre de façon positive pour bâtir un avenir meilleur. Ce qui est gênant dans la dénonciation des violations, c’est que l’objectivité y est impossible. Comment faire abstraction de ce que l’on est, de ses propres convictions ? Par exemple, dans le conflit du Proche Orient, certaines associations dénoncent les Israéliens ; d’autres associations les Palestiniens. Même les grandes organisations internationales ne peuvent éviter la partialité.
On se pose en s’opposant… En dénonçant l’autre comme un scélérat, je pense me grandir. Combien d’intellectuels, de gens de valeur, épousent systématiquement la cause du plus faible même si le faible commet des actes inacceptables ? Nos jugements nous jugent…
Malgré nos différences d’opinion, il faut continuer à dénoncer l’ensemble des violations d’où qu’elles viennent, où qu’elles soient commises et quels qu’en soient les auteurs. La construction d’un monde plus libre se nourrit de cette pluralité. Cependant, nos divergences de vues ne doivent pas aboutir à l’anéantissement de ceux qui ne partagent pas nos opinions.
Contrairement à une idée très répandue, je ne crois pas que nos différences (de couleur, culturelles, sociales…) soient à l’origine des guerres. Si on a reçu l’éducation nécessaire, on est capable d’accepter l’autre dans ses différences. Comme l’a écrit Jean Rostand : « Le biologique ignore le culturel(…) De tout ce que l’homme a appris, éprouvé, ressenti au long des siècles, rien ne s’est déposé dans son organisme, rien n’a passé dans sa bête. Rien du passé humain n’a imprégné ses moelles.(…) Chaque génération doit refaire tout l’apprentissage. Et si, demain, la civilisation entière était détruite, l’homme aurait tout à recommencer, il repartirait du même point d’où il est parti voilà quelque cent ou deux cent mille ans.(…) La civilisation de l’homme ne réside pas dans l’homme, elle est dans les bibliothèques, dans les musées et dans les codes. ». Aucun progrès humain n’étant, hélas, génétiquement transmissible, on doit surtout compter sur l’éducation (l’école, les universités) et la formation (professionnelle) pour travailler en profondeur. En attendant que des partisans des droits de l’Homme soient élus à la tête de tous les États, il faut s’armer de persévérance et poursuivre sa tâche de sensibilisation, d’éducation et de formation, qui représentent, à mes yeux, la meilleure façon de changer les mentalités.
(1) « Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l’Homme seront violés en quelque partie du monde. » René Cassin, prix Nobel de la Paix (1968).
(2) « René Cassin, fantassin des droits de l’homme » (1979. Editions Plon). « René Cassin, Père de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » (1998. Perrin).
(3) L’objectif de l’Académie Internationale des droits de l’Homme est de contribuer dans les milieux professionnels à la mise en œuvre d’une éthique des droits de l’Homme.
(4) A paraître fin 2007 aux éditions Des Idées & des Hommes et, sous la direction de Marc Agi, une trilogie consacrée aux 3 grands monothéismes et à leurs relations avec les droits de l’Homme : « Islam et droits de l’Homme » préfacé par le recteur Dalil Boubakeur (janvier 2007) ; « Judaïsme et droits de l’Homme » préfacé par le grand rabbin Sirat (mars 2007) et « Christiannisme et droits de l’Homme (mai 2007).
(5) René Dumont (1904-2001) citoyen engagé, agronome, pacifiste, tiers-mondiste, écologiste.
Vers l’homme univers, ou de la nécessité de rendre la parole à l’homme
Comments 0
- Les Di@logues Strategiques on 2 mai 2010 inLes Di@logues Strategiques
Non classé
(Les Di@logues Stratégiques® – 01/05)
*Marc Agi est également l’auteur de » l’Encyclopédie des libertés » (1997. Editions Fondation de l’Arche de la Fraternité). Par ailleurs, de 1993 à 2001, il a été directeur général de la Fondation Internationale des Droits de l’Homme, l’Arche de la Fraternité et, de 1991 à 2002, membre de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (président de la sous-commission pour l’éducation et la formation aux droits de l’Homme) où il a notamment œuvré pour l’adoption d’une » Charte d’éthique commune aux professions s’exerçant directement sur la personne humaine « . Il est actuellement chargé d’un cours sur » Les éthiques professionnelles et l’éthique des droits de l’Homme » à l’université de Nantes. Depuis quarante ans, Marc Agi combat pour faire mieux connaître les valeurs sur lesquelles reposent les droits de l’homme, et construire un monde un peu moins injuste, un peu plus libre, un peu plus solidaire. Marc Agi organise également une Université d’été internationale de formation des formateurs en droits de l’Homme et Citoyenneté démocratique qui se tient au Pôle universitaire et technologique de Vichy. Biographie.