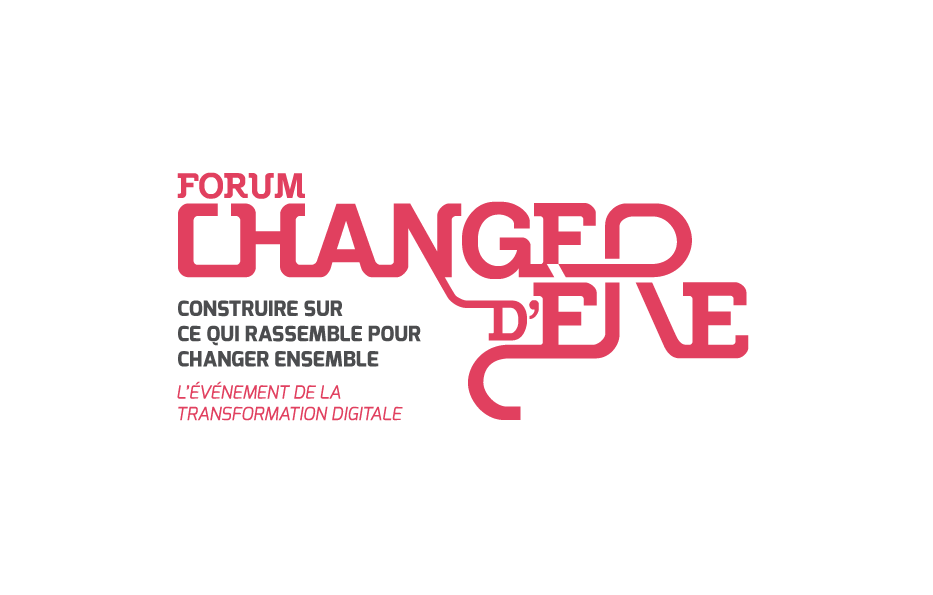Véronique Anger : La maîtrise de l’information représente un élément décisif de la compétitivité des entreprises. Comment votre société s’inscrit-t-elle dans cette guerre mondiale du renseignement ? Qui sont vos clients ? VA : Pour les entreprises, comprendre l’environnement socio-politique est essentiel pour pouvoir agir et conquérir de nouveaux marchés. Votre société travaille principalement sur le monde arabe et musulman(1), quels ont été les principaux impacts des attentats du 11 septembre sur votre métier ? VA : Existe-t-il encore une paranoïa de l’espionnage industriel et commercial ? VA : Quelle est, selon vous, la différence entre « espionnage » et « intelligence économique » au sens large, héritée de la stratégie militaire ? VA : Nous vivons une époque où les économies, les savoir-faire, les moyens, sont interconnectés. Dans le domaine de l’information et de la prévision, les analystes ont montré leurs limites (sur le plan économique : les crises boursières, sur le plan géostratégique : l’Afrique de l’Ouest, les attentats du 11 septembre,…). Comment analysez vous ces changements et ses conséquences sur l’évolution de votre métier ? VA : Les choix historiques sont souvent jugés sévèrement des décennies plus tard. Je pense, par exemple, aux différentes voies possibles en 1940 : de Gaulle ou Pétain ? Chamberlain ou Churchill ? Selon vous, existe-t-il actuellement de grands choix stratégiques d’hommes politiques qui entrent dans cette catégorie ? Pensez-vous que l’histoire donne toujours raison au vainqueur ? *Percy Kemp a fondé Tactical Studies en 1986. Ses romans » Musc » et » Moore le Maure » ont précédé » Le système Boone » chez Albin Michel. (1) Iran, Maghreb, Pakistan, Pays du golfe, Proche-Orient…
Version Anglaise
A la croisée des cultures orientales et occidentales (Britannique par son père, Libanais par sa mère, et Parisien de culture…) Percy Kemp* se sent chez lui à Paris, à Londres ou à Beyrouth.
Consultant pour Tactical Studies, une société spécialisée dans le renseignement stratégique, il est également l’auteur du best-seller « Le Système Boone », un roman d’espionnage dont l’action, sur fond de grands enjeux géopolitiques actuels, se déroule au Liban.
Percy Kemp : Nos clients visent essentiellement des marchés d’Etat : pétroliers, gaziers, grands équipementiers, industries de défense…
Les deux domaines d’activité de Tactical Studies concernent principalement l’aide à la formulation de questions précises, et le renseignement en réponse aux dites questions.
Dans le contexte de la » guerre de l’information « , le plus important n’est pas tant d’accéder à la quantité de données qui existe tout autour de nous (dans les rapports, la presse, sur le net,…) que de formuler et d’affiner des questions susceptibles de susciter des réponses pertinentes. C’est là toute la différence entre l’information (pléthorique) et le renseignement (information ciblée).
Aujourd’hui, nous sommes sur-informés, noyés sous une masse d’informations. Ce problème est d’autant plus difficile à traiter que les moyens et les modes de communication et de sécurisation des données sont très répandus.
Autrefois, l’information était difficile à acheminer en toute sécurité. Le codage nécessitait des heures de travail. Depuis une dizaine d’années, il est aisé de la disséminer très largement, quasiment en temps réel, et en totale sécurité.
Désormais, quelques secondes suffisent pour crypter des données. Cette simplicité a entraîné des effets pervers. Les professionnels chargés de produire et de transmettre les renseignements cèdent parfois à la facilité et, plutôt que de se limiter à l’essentiel, ils envoient tout et n’importe quoi.
En ce qui nous concerne, nous nous efforçons de cerner exactement le besoin du client afin de lui apporter la réponse la plus ciblée possible.
Le renseignement, le second domaine d’activité de notre société, consiste à envisager un marché en tenant compte des profils psychologiques des décideurs dudit marché. Nous pratiquons assez peu l’analyse quantitative, économique ou statistique Notre travail porte prioritairement sur l’identification des » vrais » décideurs. Qui pèse vraiment sur le choix final ? Est-ce le Ministre de la Défense, des Finances… ? Quelles sont ses motivations (techniques, culturelles, financières, psychologiques,…) ? La responsabilité de la décision est-elle éclatée ?… Mieux comprendre la psychologie et les motivations réelles des acteurs permet souvent d’éclaircir la situation et de dédramatiser les négociations.
PK : L’une des conséquences est que les sociétés sont de plus en plus soucieuses de protéger physiquement leurs expatriés et leurs installations.
Depuis le 11 septembre, nos clients sont davantage préoccupés par la stabilité politique et les risques physiques que par la guerre économique. Nous avons l’impression que le seul fait de rester dans un pays dit à risque et de n’y souffrir aucun dégât devient suffisant en soi.
Dans beaucoup de grandes sociétés, les directeurs de la sécurité ou de la logistique sont plus importants que les cadres commerciaux.
Cette logique, plus défensive qu’offensive, minimise la rivalité entre entreprises concurrentes au profit de la survie. La capacité des entreprises à conquérir de nouvelles parts de marchés s’amenuise. Notre travail est un peu moins intéressant actuellement car il exige plus de pragmatisme, mais moins d’imagination. Pour parler en termes de football, on dira que le gardien et les arrières sont aujourd’hui plus importants que les buteurs et les avants : les matches deviennent moins passionnants.
PK : Jusqu’à l’effondrement de l’Union soviétique et les récentes privatisations en Europe, le système des marchés protégés (ainsi, la France en Afrique, l’Union soviétique en Europe de l’Est) et le poids des entreprises étatiques faisaient que les intérêts des Etats se confondaient avec ceux des sociétés, et la paranoïa de l’espionnage commercial était alors bien réelle. La guerre économique opposait de vrais ennemis, des systèmes complètement différents.
Mais depuis la fin de la guerre froide, et surtout depuis la grande vague des privatisations en Europe, les grandes entreprises deviennent de plus en plus multinationales et, de ce fait, cette ancienne paranoïa tend à disparaître. La guerre économique n’oppose plus de grandes puissances ennemies, mais des rivaux commerciaux. La notion de « rival », dans la mesure où elle n’est pas idéologiquement ou politiquement fondée et où elle ne permet pas de déclencher une « guerre juste » ou une « guerre sainte », pousse naturellement à la retenue.
PK : Pour moi, la différence principale entre ce que nous pouvons appeler » intelligence économique » et ce que nous appelons » espionnage » réside dans la manière de faire. Avancez-vous à visage découvert ou non ? La méthode utilisée est-elle légale ?
La frontière est avant tout juridique. L’espionnage consiste à utiliser des moyens illégaux pour parvenir à ses fins : soudoyer le personnel d’une société étrangère ou poser des écoutes non autorisées chez un concurrent, par exemple.
Les opérations illégales peuvent avoir des conséquences désastreuses pour le donneur d’ordre, s’il est découvert. Généralement, les entreprises sont prudentes ; elles tiennent à préserver leur image et leur réputation.
PK : Les analystes ont tendance à estimer qu’un acteur de la vie économique ou politique agira intelligemment et au mieux de ses intérêts perçus. Or, il m’est avis que ce n’est pas nécessairement le cas.
Je pense que l’analyse purement quantitative et rationnelle ne peut suffire à comprendre et à expliquer ce qui se passe dans le monde, ne serait-ce que parce que les flux économiques sont le fait d’êtres humains… Certaines décisions sont prises de manière totalement subjective, voire irrationnelle, parfois sans tenir compte des intérêts matériels immédiats.
Prenons l’exemple des compagnies pétrolières. Le cout de transport du pétrole de la mer Caspienne à travers l’Iran (grâce à un système de swap(2) très avantageux) est évalué à cinquante cents de dollars par baril. Le transport de ce même pétrole, acheminé par pipeline jusqu’en Turquie, reviendrait à trois dollars, soit six fois plus…
La première solution paraît évidemment plus intéressante d’un strict point de vue financier. Pourquoi l’administration américaine, symbole du libéralisme économique, insiste néanmoins pour court-circuiter l’Iran et favoriser l’option turque Bakou/Ceyhan ? Les raisons, principalement émotionnelles et idéologiques, dépassent le simple cadre économique.
Les analystes sont souvent incapables d’anticiper des décisions de ce type, puisqu’ils n’intègrent pas les motivations humaines et irrationnelles dans leurs études. Pourtant, la connaissance des hommes, de ce qui pourrait faire pencher leur choix pour tel pays, culture, ou fournisseur, est précieuse.
Autre exemple : nous ne répéterons jamais assez à quel point les motivations personnelles ont pesé sur la décision d’Oussama Ben Laden de s’attaquer à l’Amérique : Ben Laden, que les Américains avaient instrumentalisé dans le cadre de leur guerre contre les Soviétiques en Asie centrale et qui, par la suite, avait été lâché par ces mêmes Américains, s’était senti trahi.
Chez Tactical Studies, nous faisons peu de grandes études quantitatives. En revanche, notre atout essentiel repose sur le relationnel, et sur notre habilité à comprendre ce qui peut influencer un décideur, qu’il soit politique ou économique. Nous nous intéressons surtout à la nature et à la psychologie humaine, et nous essayons d’aller au-delà ce qu’un décideur peut faire (son potentiel) pour toucher à ce qu’il veut faire (ses intentions).
PK : La question du choix est très intéressante. Rétrospectivement, si nous étudions le cas de Chamberlain(4) nous nous apercevons qu’il a fait le mauvais choix. En revanche, Churchill(5) a fait le bon choix dès le début des années 30, en s’opposant farouchement à toute concession à l’Allemagne et en prônant le réarmement britannique.
Mais nous oublions de préciser que Churchill prenait le contre-pied du gouvernement de l’époque à un moment où il effectuait sa traversée du désert… Finalement, l’histoire lui a donné raison, mais sa motivation était purement personnelle et » politicienne « . Elle relevait en fait d’une vision.
Je pense que des choix similaires se présentent à nous aujourd’hui, mais ils ne sont pas tranchés. Je pense que cela tient à la psychologie des décideurs.
Au fil du temps, deux tendances se sont clairement affirmées, que ce soit à la tête d’Etats ou de grands groupes. La première est la montée de ce que j’appellerais les gestionnaires. La période de crise, de croissance lente, que nous avons vécue, a encouragé l’arrivée à des postes-clé de personnalités qui ne possèdent pas forcément le profil ou la psychologie du vrai décideur. Cette tendance n’encourage pas les choix courageux. Or, décider signifie aussi : prendre des risques.
J’ai remarqué une deuxième tendance : la diplomatie. L’équilibre des forces instauré au cours des années de guerre froide(6) a consacré le multi-latéralisme dans les relations internationales. Alors, chaque problème trouvait sa solution au sein de l’ONU, dans des concertations multilatérales fondées sur l’équilibre entre les deux » blocs « . Chacun savait jusqu’où il lui était possible d’aller (les Russes pouvaient s’adjuger la Hongrie pourtant peu communiste, mais pas la Grèce ou l’Italie bien que ceux-ci avaient des partis communistes puissants). Les négociations étaient affaire de juristes, de spécialistes recourant à des arguments logiques.
Certains pays sont rapidement sortis de ce consensus. Notamment Israël, considérant que son droit à se défendre prédominait sur le droit international. Au nom de ce droit de survie, cet Etat n’a pas hésité à violer les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.
Après avoir longtemps été tributaires de leurs mentors soviétiques ou américains, les Arabes et les Musulmans ont eux aussi commencé à sortir du consensus au nom d’une justice ou d’un droit divins supérieurs au droit international.
Le flou et l’incertitude dans lesquels nous vivons depuis la fin de la guerre froide nécessitent de vrais décideurs, capables de prendre des risques et, dans le contexte actuel, un Ariel Sharon convient mieux à Israël qu’un Shimon Peres. Dans le même ordre d’idée, un Oussama Ben Laden me semble plus en phase avec les aspirations des masses arabo-musulmanes que n’importe quel gouvernement arabe.
Je ne porte aucun jugement de valeur. Je ne dis pas que ces décideurs-là ont raison ou tort, je constate simplement un fait.
Lorsque, après les attentats du 11 septembre, les Etats-Unis décidaient de passer à l’offensive contre Al-Qaida et le régime Taliban en Afghanistan, nonobstant la présomption d’innocence, leurs alliés européens, encore sous le choc, les ont volontiers suivis. Mais plus tard, lorsque ces mêmes Etats-Unis ont demandé le soutien de leurs alliés contre l’Irak, en l’absence de preuve formelle de l’existence d’armes de destruction massive irakiennes et de liens entre les terroristes islamistes et les Irakiens, les Européens (en particulier les Allemands et les Français) revenus du choc du 11 septembre ont refusé, s’en remettant à l’ancienne logique de la négociation multilatérale.
Je suis convaincu que notre conception, héritée du XXème siècle, de ce qui est juste et de ce qui ne l’est pas ; de ce qui est bien et de ce qui ne l’est pas, de ce qui est acceptable et de ce qui ne l’est pas, n’est plus adaptée au monde du XXIème siècle. Mais cela ne signifie pas que nous sommes prêts à changer. Le tollé européen contre G.W. Bush, le tollé libéral contre Ariel Sharon, le tollé occidental contre Oussama Ben Laden, voire le tollé de la société civile française contre Nicolas Sarkozy, en font foi. Nous refusons toujours les rois-magiciens. Nous leur préférons la figure plus rassurante du « prêtre-juriste ». Reste à savoir si les prêtres-juristes du XXème siècle sont habilités à gérer les incertitudes du XXIème.
Il a également publié deux essais : » Territoires d’Islam » (Paris, Sindbad-Actes Sud : 1982) et » Majnûn et Laylâ » (en collaboration avec André Miquel, Paris, Sindbad-Actes Sud : 1984).
Il a, en outre, signé une cinquantaine d’articles sur des sujets variés allant de l’Islam à l’espionnage, dont les plus récents sont « La nouvelle Rome et ses Carthage » (in Esprit, aôut/septembre 2002) et « La loi du talion » (in Le Nouvel Observateur, 24 octobre 2002). En savoir plus sur Tactical Studies : http://www.tacticalstudies.com.
(2) Troc, en français
(3) A ce sujet, nous vous recommandons les articles : « Les grandes manœuvres autour de la Caspienne » (Le Monde du 25/05/02) et « Pétrole : l’Occident dans le champ de Moscou » (Libération. Nov. 02)
(4) Premier ministre britannique (1937-1940) qui essaya vainement de régler pacifiquement les revendications allemandes (accords de Munich de 38). Il dut finalement déclarer la guerre à l’Allemagne en 39
(5) Premier ministre britannique (1940-1945 et 1951-1955) leader du parti conservateur, et l’un des protagonistes de la victoire alliée
(6) De 1945 à 1990.
Notre conception de ce qui est acceptable ou non n’est plus adaptée au monde du XXIème siècle
Comments 0
- Les Di@logues Strategiques on 2 mai 2010 inLes Di@logues Strategiques
Non classé
(Les Di@logues Stratégiques® N°37 – 11/02)