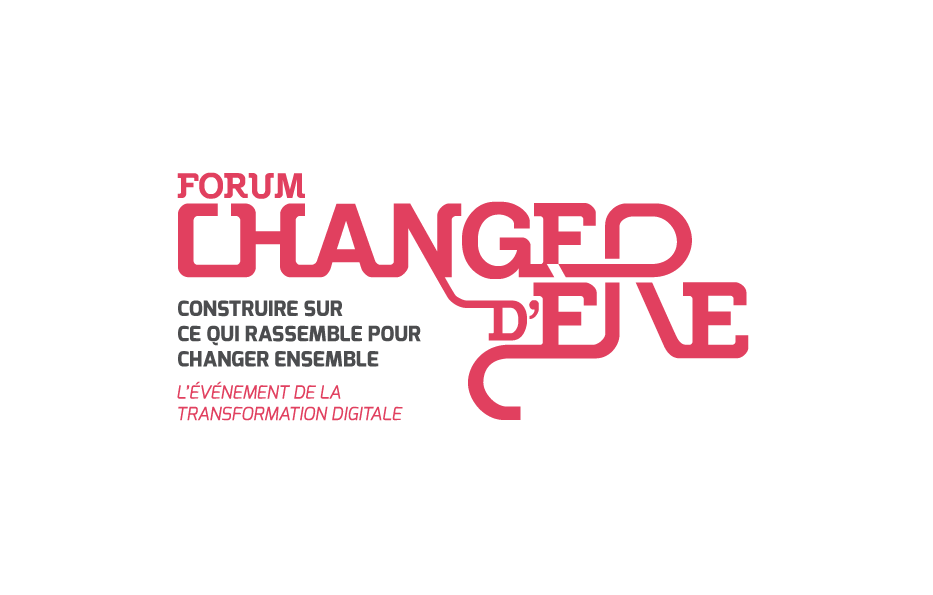Véronique Anger : Pourriez-vous donner une définition du cercle de qualité ? VA : Comment les CQ sont-ils apparus en France, et quels grands changements ont-ils générés ? VA : Votre société, AGORHOM, proposait d’aider les entreprises à mettre en place les CQ. Avec le recul, comment analysez-vous ce phénomène ? VA : La qualité totale serait donc une suite logique aux cercles de qualité ? (1) Diagrammes d’Ishikaw ou, des causes et des effets, diagramme de Pareto, grille de décision,… *En 1976, Guy Imbert (aujourd’hui retraité) fondait la société » FORHOM » spécialisée dans » la formation des hommes » devenue peu après « AGORHOM » avec ses Ateliers et Groupes Opérationnels de Recherche d’Améliorations (AGORA). Ces groupes opérationnels de recherche ont permis de faire la liaison entre les équipes autonomes et les cercles de qualité.
A l’origine du « miracle » économique japonais dans les années 60/70, les cercles de qualité (CQ) ont fait leur apparition en Europe, puis aux Etats-Unis à la fin 70/début 80.
Les entreprises occidentales y voyaient une réponse à leur recherche de « qualité » ainsi qu’un moyen d’augmenter la productivité, d’améliorer le climat social ou de mobiliser les salariés.
Pour Guy Imbert*, fondateur de la société AGORHOM et l’un des pionniers de la démarche qualité en France, les grandes campagnes axées sur la qualité totale, très en vogue au milieu des années 90, puisent leurs sources dans les CQ et les équipes autonomes.
Guy Imbert : Il s’agit d’un groupe, généralement permanent, de cinq à neuf volontaires qui, sous la direction et l’animation d’un supérieur hiérarchique direct, étudie, élabore et décide de la mise en œuvre de solutions visant à améliorer tous les problèmes liés à leur activité (techniques, qualité, sécurité, humains, production,…).
Tous les membres du cercle de qualité travaillent ensemble (dans l’équipe, le bureau, l’atelier, sur le chantier,…) et sont collectivement responsables. Ils utilisent une méthode et un langage communs (outils adaptés(1) et tableau de bord) pour résoudre ces questions. Cette règle de base facilite la compréhension et favorise la convergence des idées vers un même but d’efficacité.
A partir d’un concept simple (la participation de tous les travailleurs) de multiples solutions peuvent émerger. C’est ce qui a fait le succès des cercles de qualité.
L’AFCERQ(2), créée en 1980, s’est imposée comme le garant et le promoteur de ce concept adapté à la culture, aux habitudes, aux préoccupations et aux organisations de notre pays.
GI : Inventés au début des années 60 par un ingénieur-chimiste, Kaoru Ishikawa (1915/1989) très impliqué dans le mouvement japonais de la qualité, les CQ ont conquis la France à la fin des années 70.
Nés d’une prise de conscience de la nécessité d’adapter les entreprises au contexte économique et social « moderne », les cercles de qualité sonnent le glas du taylorisme…
Déjà, dans les pays industrialisés, l’entreprise évoluait de plus en plus rapidement. Le prolongement de la scolarité, le développement des nouveaux médias (la télévision notamment) ont modifié les comportements et les modes d’accès à la connaissance. Désormais, le « travailleur » est considéré comme « capable de réfléchir ». De simple exécutant, il devient « travailleur pensant ».
L’entreprise moderne va saisir cette opportunité et permettre au plus grand nombre d’exprimer et d’échanger des idées. Le cercle de qualité va traduire, par des actions concrètes, cette volonté de prise en compte de l’individu.
Cela paraît évident aujourd’hui, mais il faut se rappeler que l’ouvrier d’alors exécutaient des tâches précises et minutées, sous la direction de cadres (techniciens supérieurs ou ingénieurs) censés posséder le savoir et la science.
Les temps ont changé, et l’un des initiateurs de ce changement se nommait Hyacinthe Dubreuil (1883/1971). Compagnon du Devoir(3), Secrétaire général du syndicat des ouvriers mécaniciens de la Seine en 1914, mécanicien chez Ford à Detroit aux Etats-Unis, Hyacinthe Dubreuil souhaitait démystifier le « travail/châtiment » pour retrouver le « travail/joie » et le « travail/responsabilité ». Sa devise s’exprimait ainsi : « Toute organisation sociale repose sur trois éléments : matériel et économique (estomac) ; intellectuel (cerveau) ; moral et affectif (cœur). Or, avec le taylorisme, le plan matériel et économique est l’affaire des syndicats ; le plan intellectuel est annihilé ; de même, le plan moral et affectif est quasiment ignoré. ». Toute sa vie, il chercha une réponse « à la française » pour cette équation à trois variables.
Il laissa aux organisations syndicales le soin de s’occuper des aspects matériels. Il proposa le travail en équipes autonomes et responsables pour les aspects cœur et cerveau. Les membres de chaque équipe devaient organiser leur planning et améliorer leur travail en permanence, grâce à la discussion, et tout en étant responsables collectivement. Cette formule se rapprochait déjà des CQ. Vous voyez que ce courant ne date pas d’aujourd’hui !
GI : Lorsque j’ai créé AGORHOM en 76, j’étais très influencé par l’approche de Hyacinthe Dubreuil, qui pensait « l’homme dans l’entreprise avec sa responsabilité dans l’équipe autonome ».
Notre société préférait parler d' »Ateliers et Groupes Opérationnels de Recherche d’Améliorations » plutôt que de cercles de qualité. Nous craignions à l’époque que ce terme, somme toute un peu réducteur, limite la recherche des groupes au seul aspect » qualité » qui est un point important parmi d’autres.
Trop de consultants se sont lancé dans cette démarche sans en avoir correctement évalué les risques ou les impacts. Les conséquences sur les processus hiérarchiques traditionnels (pyramidales) imposaient de repenser les modes de management. L’implication de tous était indispensable, à chaque niveau de décision. En effet, le CQ constituait une force de propositions et d’actions qui, mal maîtrisée ou en conflit avec la stratégie d’entreprise, risquait de conduire à l’échec.
A AGORHOM, nous estimions que seule une entreprise sur trois était prête (début 80) à déployer efficacement les CQ. Nous pensions également qu’il faudrait à celles-ci de un à cinq ans pour que le travail mené dans les groupes commence à porter ses fruits. La sensibilisation de l’encadrement, la conduite du changement, la formation à l’animation de groupe et aux méthodologies de résolution de problèmes réclament beaucoup de temps. Mais une fois la machine bien huilée, que de satisfactions !
GI : Toutes ces idées ont fait leur chemin pendant une vingtaine d’années, puis la qualité totale a pris la place des CQ au milieu des années 90. Les démarches de qualité totale se sont d’abord appuyé sur les cercles de qualité. Ensuite, les « qualiticiens » ont pris le relais et les CQ ont disparu. Nécessaires pour ré-humaniser les rapports individu/travail, ils sont devenus insuffisants pour déployer la qualité totale. En revanche, les outils qui ont servi aux CQ (techniques d’animation de groupe, d’analyse des problèmes,…) ont continué à être utilisés pour la qualité totale.
Quoi qu’il en soit, je pense que les cercles de qualité ont révolutionné la façon de concevoir les relations au sein de l’entreprise tout en imaginant un nouveau style de management humain.
(2) Association Française des Cercles de Qualité
(3) Ou AGORA
Equipes autonomes et cercles de qualité : un avant-gout de qualité totale
Comments 0
- Les Di@logues Strategiques on 2 mai 2010 inLes Di@logues Strategiques
Non classé
(Les Di@logues Stratégiques® N°22 – 12/01)