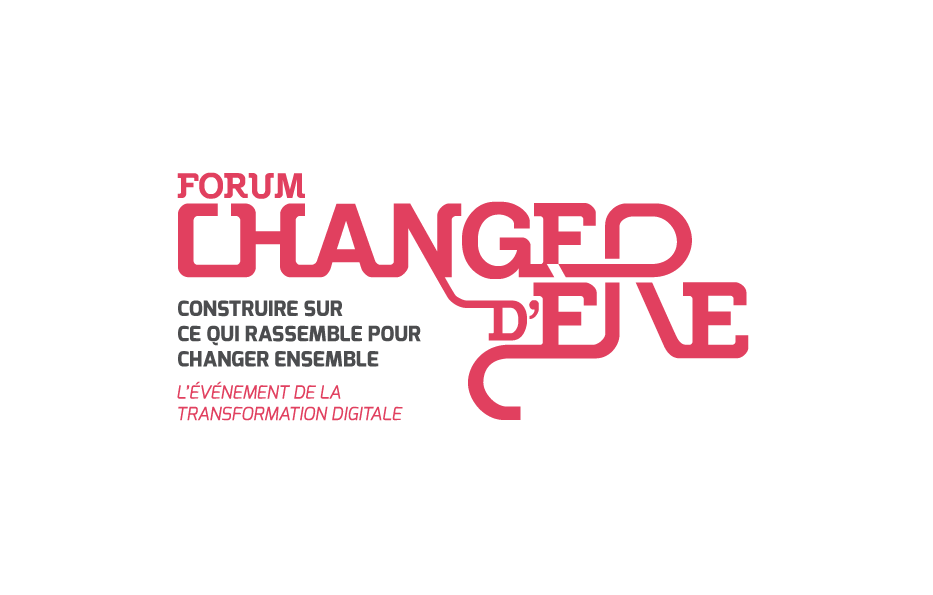« Avec l’effondrement du bloc communiste, les conditions avaient été réunies pour une exportation de la démocratie sous l’égide des Etats-Unis. Ce fut l’ère Clinton de l’exportation soft du modèle américain par la diplomatie, l’économie, la culture, l’aide humanitaire et le combat pour la transparence et les droits de l’Homme. Mais après le 11 septembre, ce sont les conditions nécessaires à une exportation musclée de la démocratie qui se sont trouvé réunies. Nous sommes alors entrés dans une logique guerrière qui ne se contente pas de bouleverser les relations internationales mais qui altère aussi les fondements de nos propres sociétés. Celles-ci deviennent plus sécuritaires, plus autoritaires, et moins fondées sur la recherche de la vérité. Ayant vaincu les démocraties populaires, les démocraties libérales cèdent la place aux démocraties populistes. » Percy Kemp*, consultant, essayiste et romancier, nous propose sa vision du monde moderne.
Véronique Anger : Dans une interview à la revue Esprit(1), vous empruntiez au philosophe Michel Foucault les notions d’ « Intérieur » et d’ « Extérieur » pour essayer de comprendre les nouvelles relations internationales.
Percy Kemp : Dans son Histoire de la folie à l’âge classique, Foucault montre comment que les lépreux étaient confinés dans des léproseries situées hors des murs de la Cité, à « l’intérieur de l’Extérieur », en quelque sorte, alors que les fous étaient enfermés dans des asiles situés au sein même de la Cité, en quelque sorte à « l’extérieur de l’Intérieur ». Il m’a semblé que cette dichotomie Intérieur/Extérieur pouvait nous aider à mieux comprendre les nouvelles relations de pouvoir et les nouvelles relations internationales qui se sont nouées depuis la fin de la Guerre froide.
Schématiquement, on pourrait dire que les pays occidentaux, occidentalisés et industrialisés (Etats-Unis, Union européenne, Israël, Japon, Corée du Sud,…) font partie du bloc de l’Intérieur, alors que l’Extérieur regrouperait tous les pays non industrialisés et peu ou pas occidentalisés, ainsi que toutes les nations qui ne partageraient pas les valeurs propres à l’Intérieur (ainsi, la Corée du Nord, Cuba, l’Irak de Saddam Hussein, l’Iran, la Libye, la Syrie). Ils seraient en quelque sorte les lépreux des temps modernes.
Schématiquement, aussi, on pourrait dire que les exclus sociaux, les marginaux, les asociaux, les inadaptés, les immigrés clandestins, qui se trouvent chez nous, à l’Intérieur, mais qui n’en sont pas moins confinés dans des cités de banlieue, des ghettos, des bidonvilles, des prisons, voire chez eux (ainsi, le nouveau projet de loi britannique permettant de placer en résidence surveillée toute personne suspectée d’être liée au terrorisme) sont les fous des temps modernes et se retrouvent enfermés à « l’extérieur de l’Intérieur ».
VA : Comment les relations se nouent-elles entre l’ « Intérieur » et l’ « Extérieur » ?
PK : Les mêmes règles ne s’appliquent pas selon qu’on traite avec l’Intérieur ou avec l’Extérieur. Les membres du bloc de l’Intérieur peuvent être tour à tour alliés, rivaux, complices, concurrents, partenaires ou adversaires, mais leur existence n’est jamais remise en cause par les autres membres du bloc. Des règles très strictes, empêchant le dérapage vers la violence, régissent leurs relations, et elles sont respectées par tous. Mais avec l’Extérieur, ces règles ne s’appliquent pas. Les relations sont ici essentiellement fondées sur la violence. L’existence de » l’Autre » et sa différence sont niées et sa neutralisation -sinon sa destruction pure et simple- souhaitée.
Car si les relations entre pays membres du bloc de l’Intérieur sont fondées sur le concept de rivalité et dessinent des stratégies de pouvoir s’appuyant sur la diplomatie, la négociation, la persuasion ou, à la limite, la désinformation et la subversion, les relations entre l’Intérieur et l’Extérieur sont, elles, fondées sur le concept d’inimitié, et elles mettent en branle des stratégies s’appuyant principalement sur la violence (répression policière et puissance militaire).
VA : On pourrait traduire cela par : ce qui est interdit entre « gens de bonne compagnie » est toléré avec ceux qui n’appartiennent pas au club…
PK : C’est précisément cela. Selon que la cible se trouve être à l’Intérieur ou à l’Extérieur, les règles s’appliqueront ou pas. Ce que le respect des règles interdit entre pays de l’Intérieur, devient légitime avec ceux de l’Extérieur. On pourrait appeler cela la « règle de l’arbalète ». Comme vous le savez, au Moyen-Age l’arbalète était une arme aussi meurtrière que prisée. Elle fit d’ailleurs tant de ravages dans les rangs de la chevalerie occidentale, qu’en 1139 le concile de Latran décida d’en interdire catégoriquement l’usage entre armées chrétiennes, tout en permettant son utilisation contre les » Infidèles « . Français et Américains n’utiliseront donc pas l’arbalète pour régler leurs différends, mais ils l’utiliseront volontiers pour régler son compte à un ennemi de l’Extérieur.
L’Américain Boeing pourra ainsi espionner son rival européen Airbus, mais les Américains ne déclareront pas pour autant la guerre à l’Union européenne. Ils useront, pour faire prévaloir leurs intérêts dans cette affaire, de diplomatie, d’influence, de pressions, de désinformation à la limite de la déstabilisation, mais sans pour autant dépasser un certain seuil et atteindre un seuil de violence. En revanche, avec l’Irak, les Américains useront de la menace et de la force armée. Après la dernière intervention américaine en Irak, tout le monde s’était étonné de la marginalisation du Secrétariat d’Etat, et de l’inefficacité de la CIA. Mais la question n’est pas là. Dans la mesure où la Maison Blanche avait déjà planifié l’utilisation de la force militaire contre l’Irak, la diplomatie et le renseignement devenaient par conséquent secondaires ne servant, au mieux, qu’à vendre à l’opinion publique et aux alliés une guerre qui avait déjà été décidée.
La même logique qui s’applique à « l’intérieur de l’Extérieur » s’applique d’ailleurs aussi à « l’extérieur de l’Intérieur ». Nos polices urbaines useront de renseignement, de présence affichée et de dissuasion afin de faire respecter l’ordre dans les rues de nos capitales, mais ailleurs, dans ces cités de banlieues et ses ghettos qui sont autant d’entités extraterritoriales, ce ne seront pas tant le renseignement, la présence et la dissuasion qui auront cours que la confrontation, tant ponctuelle que violente.
VA : Comment le rapport des forces entre l’ « Intérieur » et l’ « Extérieur » évolue-t-il ?
PK : En l’absence d’un pôle alternatif de pouvoir et d’attraction, suite à l’effondrement de l’Union soviétique, nombreux sont les pays de l’Extérieur qui finissent par accepter la pax americana (ainsi l’Autorité palestinienne et, plus récemment, la Libye du colonel Kadhafi). D’autres s’effondrent au premier coup de boutoir faute de moyens internes (ainsi, le régime des Taliban en Afghanistan) ou faute d’alliés de poids (ainsi, l’Irak de Saddam Hussein qui aurait certainement bien mieux résisté aux Américains si nous étions encore en pleine Guerre froide). Ces pays-là placent alors volens nolens leurs destinées entre les mains des principaux pouvoirs constitutifs de l’Intérieur et ils tombent, selon le cas, sous la tutelle du FMI et de la Banque Mondiale, de l’OTAN, des multinationales, de Washington, ou de tel ou tel allié privilégié des Etats-Unis.
Tout ce qui compte se passe ensuite à l’Intérieur même et alors l’Extérieur ne compte plus, ou presque plus. Ainsi, si, entre la fin des années soixante et la fin du siècle dernier, les Palestiniens avaient été maîtres de leurs destinées, usant de toutes les armes dont ils disposaient -y compris du terrorisme- afin de renforcer leur position ; aujourd’hui, leur sort ne dépend plus d’eux. Aujourd’hui le sort des Palestiniens (nation de l’Extérieur) se joue à l’Intérieur, au sein de la Knesset entre factions et partis israéliens rivaux mais non ennemis, comme dans les discussions entre Israéliens et Américains. Personne ne croit vraiment que les attaques du Jihad, du Hamas ou des Brigades d’Al-Aqsa, ont pesé sur la décision du gouvernement israélien de se retirer de la Bande de Gaza. Cette décision est le résultat d’un débat politique et éthique propre à la société israélienne, et de négociations entre Israël et son allié américain. C’est désormais à l’Intérieur (en métropole en quelque sorte) que se décide le sort de l’Extérieur (des nouvelles colonies).
VA : Votre commentaire rejoint un article de Régis Debray paru dans Le Monde il y a de cela une vingtaine d’années : « Il faut des esclaves aux hommes libres ». Nos démocraties ne peuvent-elles fonctionner sans impérialisme ?
PK : Il y a beaucoup de cela. De tout temps il a fallu des esclaves aux hommes libres. Athènes, Rome, ou l’Angleterre impériale en sont des exemples. Mais il y a plus. Et ce plus est à rechercher dans la logique guerrière qui fonde et justifie le pouvoir des nouvelles élites occidentales nées du 11 septembre. Sans l’Extérieur, il n’y aurait pas de menace, pas d’ennemi, donc pas de guerre, donc pas de constitution de nouveaux pouvoirs se nourrissant justement de la peur de la menace, de l’identification de l’ennemi, et d’un projet de neutralisation et de destruction dudit ennemi.
Prenons le cas de l’actuel président américain. Mal élu, souffrant d’un manque de légitimité, c’est dans la guerre qu’il s’est enfin trouvé et qu’il a pu construire son pouvoir et sa légitimité. Il a lancé une croisade armée contre les forces du mal, et il se définit lui-même comme un président de guerre, un chef de guerre. Sans la guerre, George W. Bush serait vite passé à la trappe de l’Histoire.
Les élites qui prennent aujourd’hui subrepticement le pouvoir à l’Intérieur ont besoin, pour se constituer justement en pouvoir cohérent et pour asseoir leur domination, de la permanence d’un Extérieur menaçant. J’en veux pour preuve que même quand l’Extérieur demande à dialoguer avec l’Intérieur, on le lui refuse. Saddam Hussein était allé très loin dans les concessions faites aux Américains. Il s’était vraiment « déculotté ». Cela n’a pas empêché les Américains de lui faire la guerre. De même, les terroristes islamistes cherchent, à travers leurs actes de violence, à prendre langue avec leurs ennemis occidentaux. Les dernières déclarations publiques d’Oussama Bin Laden vont d’ailleurs clairement dans ce sens. Mais on refuse de dialoguer avec lui. A la logique politique qui sous-tend le terrorisme, on répond par une logique guerrière qui nie justement le politique. Je vous renvoie ici à mon article sur le sujet paru dans la revue Esprit(2) dans lequel je développe la thèse selon laquelle le terrorisme est un acte essentiellement politique auquel nous répondons sur un mode purement guerrier qui nie le politique.
Qu’on ne s’y trompe pas, le but de la guerre déclarée par les Etats-Unis après le 11 septembre n’est pas la victoire. Le but de cette guerre, c’est la poursuite de la guerre. La perpétuation de l’état de guerre. Quand on y pense, Washington n’aura déclaré la guerre ni à Beijing ni à Pyongyang, mais à un régime afghan moyen-âgeux, à un régime irakien désarmé et à des organisations terroristes artisanales. En d’autres termes, les Américains auront déclaré une guerre qu’ils ne pouvaient pas perdre à un ennemi qui, lui, ne pouvait pas la gagner.
VA : Cette logique guerrière s’avère payante puisque, d’un côté le président Bush a pu asseoir son pouvoir et se faire réélire et, de l’autre côté, la guerre en Afghanistan et celle en Irak ont poussé des dictateurs tels le colonel Kadhafi à obtempérer.
PK : C’est vrai. Mais la machine de guerre sur laquelle repose cette logique guerrière a aussi ses limites. Si certains pays de l’Extérieur se plient à la volonté de Washington, il en est d’autres, comme la Corée du Nord, l’Iran ou Cuba, qui refusent le diktat américain. Contrairement à l’Irak, à la Libye ou aux Palestiniens, eux ont encore les moyens de répondre aux arbalètes américaines en tirant leurs propres arbalètes. Ces pays-là sont un morceau bien plus coriace à avaler, que ne le furent le régime castré et mis en quarantaine de Saddam Hussein, celui démoralisé de Kadhafi, ou celui édenté du Mollah Omar. Et c’est justement là, quand la machine de guerre américaine a montré ses limites, que la démocratie vient en prendre le relais, reconduisant ainsi la stratégie de pouvoir élaborée par Washington.
VA : Vous voulez parler du droit d’ingérence ?
PK : Il ne s’agit pas de n’importe quel droit d’ingérence. Le principe du droit d’ingérence est bien antérieur au 11 septembre et à l’arrivée de George W. Bush au pouvoir. L’Administration Clinton avait beaucoup œuvré en ce sens : droits de l’Homme, lutte contre la corruption, aide humanitaire… Mais le droit d’ingérence démocratique va bien plus loin. Avec l’Administration Bush, l’exportation du modèle démocratique occidental est utilisée afin de miner et de déstructurer des pouvoirs qui restaient hors de portée de l’arbalète américaine, et pour empêcher aussi la constitution de pouvoirs forts qui pourraient éventuellement défier la puissance américaine.
Car si, dans les démocraties libérales, la cohérence du pouvoir politique, la puissance militaire, le progrès scientifique et les exploits technologiques n’étaient pas jusqu’ici antinomiques avec les pratiques démocratiques et les libertés individuelles, il n’en va pas nécessairement de même ailleurs. Il est des sociétés où la cohérence, le progrès et l’exploit sont tributaires d’un pouvoir autocratique. Est-ce un hasard si, en Russie par exemple, au pouvoir autocratique des tzars a succédé non pas un pouvoir démocratique, mais le pouvoir tout aussi autocratique des Bolcheviques ? Est-ce un hasard si c’est sous le régime communiste que la Russie a réussi ses plus belles percées politiques et militaires et ses plus beaux exploits scientifiques et technologiques ? Est-ce un hasard si la Russie post-soviétique et démocratique fut un pays en déshérence et si un nouveau tour de vis s’y dessine aujourd’hui ? Ce n’est pas un hasard. Un sondage très sérieux effectué en Russie en 2003 concluait d’ailleurs qu’une majorité de Russes préférait un régime autoritaire qui leur assurerait des bénéfices sociaux à un régime démocratique. Il semblerait que la formation sociale russe soit telle que, contrairement à ce qui est le cas dans les formations sociales occidentales, pouvoir et progrès y soient antinomiques avec démocratie et libertés. Je vous renvoie ici au très beau petit roman de Vassili Grossman « Tout passe« (3). Vous y lirez, sur la Russie, des pages d’une intuition rare qui feraient pâlir d’envie et rougir de honte bon nombre d’historiens et de politologues.
Si j’ai raison de penser que ce qui fut longtemps bon pour l’Occident ne l’est pas nécessairement ailleurs, alors il faut croire qu’en faisant de la démocratie son cheval de bataille (au vrai sens du terme) l’Administration américaine ne cherche, ni plus ni moins, qu’à déstructurer le pouvoir dans les pays cibles. Car dans ces pays-là, la démocratisation est le plus souvent synonyme d’atomisation. L’Irak post-Saddam et l’Afghanistan post-Talibans sont là pour le prouver. En exportant sélectivement leur modèle démocratique, les Etats-Unis n’apportent pas tant liberté à des populations qui n’ont pas de traditions démocratiques au sens occidental du terme, qui n’aspirent pas à la liberté telle que nous l’entendons et qui n’en demandent d’ailleurs pas tant. En exportant leur modèle démocratique, les Américains ne font en réalité que créer des ersatz d’eux-mêmes. Des ersatz faibles et inoffensifs. En réalité, les Etats-Unis ont aujourd’hui autant besoin de démocraties fortes et indépendantes, que l’Union soviétique avait jadis besoin d’une Chine communiste forte et indépendante. Ce que les Etats-Unis veulent, ce sont des démocraties sous influence dirigées par des élites fragiles, coupées de leurs racines et de leurs traditions et qui dépendraient d’eux. Des démocraties assistées.
De son temps, l’Administration Clinton avait beaucoup fait afin de promouvoir la démocratie. Et elle l’avait fait globalement. Par principe, en quelque sorte. Au nom du libéralisme. L’Administration Bush, elle, prône une application ciblée du modèle démocratique. Ainsi, les Etats-Unis prônent et encouragent un changement démocratique à Téhéran où ils souhaitent ardemment voir intervenir un changement de régime, mais ils s’accommodent fort bien du gouvernement autocratique d’Ouzbékistan. La démocratie prônée par l’Administration Bush nous apparaît alors pour ce qu’elle est vraiment : une stratégie de pouvoir qui prend le relais aussitôt que la machine de guerre montre ses limites.
J’en conclus qu’entre Bill Clinton et George W. Bush, il n’y a pas eu qu’une simple alternance entre un président démocrate et un président républicain. Il y a eu mutation du pouvoir, qui annonce une mutation de nos sociétés.
VA : Quel genre de mutation ?
PK : Depuis le 11 septembre que l’Administration Bush a érigé en nouveau Pearl Harbor, les démocraties libérales vivent un état d’exception qui ne dit pas son nom. Je ne m’étendrai pas sur la panoplie impressionnante des nouvelles mesures juridiques et sécuritaires qui grèvent les droits civiques, limitent les libertés individuelles, violent l’intimité des gens et font de tous des citoyens sous haute surveillance. Je me contenterai de constater que personne ou presque ne proteste.
Et s’il n’y a pas de vraie protestation, c’est que tout un chacun est convaincu qu’il y a une menace réelle et que l’état de guerre est justifié. Mais ce qu’on ne dit pas, c’est que cette guerre n’a pas vraiment de fin. Tout comme hier Trotsky avec sa Révolution permanente, l’Administration Bush prône aujourd’hui la Guerre permanente. Comme le souligne Timothy Snyder : « la ressemblance fondamentale entre l’Oceania [de George Orwell] et l’Amérique [de George W. Bush] réside dans la négation, par la rhétorique de la guerre, de toute discussion politique. A la fin de 1984, le lecteur se rend compte que les guerres continuelles d’Oceania […] ne servent en fait qu’un seul but : dérouter la population et permettre ainsi sa manipulation et sa domination. »(4).
Depuis quelques années, mais surtout depuis le 11 septembre, nos sociétés vivent effectivement dans la peur. Peur du chômage, de la déchéance sociale, de la dilution d’identité, mais aussi peur de l’insécurité, des attentats, des armes de destruction massive. Et le pouvoir suscite ces peurs, les exagère et s’en nourrit. Il s’en sert ensuite afin de générer encore plus de pouvoir et mieux dominer la société civile.
En se laissant gagner par la peur, la société civile tourne le dos au discernement sans lequel elle ne saurait faire un vrai choix citoyen. Elle fait aussi l’impasse sur la recherche de vérité qui la fonde pourtant depuis la Renaissance. Et elle reconduit-elle amplifie, même-les mensonges du pouvoir. Richard Nixon était tombé du fait de ses mensonges dans le Watergate. Ronald Reagan et Bill Clinton avaient tous deux été sérieusement ébranlés par les mensonges entourant, respectivement, « l’Irancontragate » et le « Monicagate ». Pourtant, aujourd’hui, et malgré les mensonges flagrants de George W. Bush au sujet des armes irakiennes de destruction massive et de l’implication de Saddam Hussein dans le terrorisme, il n’est nulle part question d’un quelconque « Iraqgate ». Qui plus est, George W. Bush a été réélu haut la main. Il a aussi réussi à imposer au Sénat et à l’opinion comme nouveau ministre de la Justice le conseiller juridique de la Maison Blanche qui avait le plus fait pour justifier l’usage de la torture. En d’autres temps on aurait dit, après Shakespeare : « Il y a quelque chose de pourri dans le royaume. ». Plus maintenant.
Le fait est que la vérité n’intéresse plus. Les enfants gâtés de la démocratie libérale se détournent de leur héritage culturel et moral et se font complices d’un pouvoir qui, tout en se drapant d’idéaux nobles, fait appel, pour opérer et pour prospérer, aux pulsions les plus primaires. Le débat politique qui était au fondement de la démocratie libérale a cédé la place à des slogans démagogiques, au « Newspeak »(5) et George Orwell aura finalement eu raison : « La guerre est la paix ! La liberté est esclavage ! L’ignorance est force ! ».
Le peuple, au sens athénien et romain du terme, n’existe plus. On passe de la souveraineté du peuple à celle de la populace. Un lien direct se noue entre les démagogues et la rue, par l’entremise des mass media. On fait l’impasse sur les élites culturelles et intellectuelles qui, dans les démocraties libérales, servaient traditionnellement de caisses de résonance et de courroies de transmission entre le haut et le bas. Le populisme remplace la démocratie et la démagogie se substitue au débat politique.
Se targuant d’une certaine immanence (Dieu, l’Etre Suprême, le Bien, la Patrie) le nouveau pouvoir né de la logique guerrière marginalise les élites traditionnelles et s’appuie sur les « petits Blancs » dont il attise la peur et les hantises. Pour reprendre l’exemple de Rome, je dirais que le Sénat, les Patriciens, les Chevaliers, sont neutraliséss et César gouverne seul en s’appuyant sur les bureaucrates, les mass media, et la plèbe qu’il gave de pain et de jeux télévisés. Ayant vaincu les démocraties populaires, la démocratie libérale cède la place à la démocratie populiste.