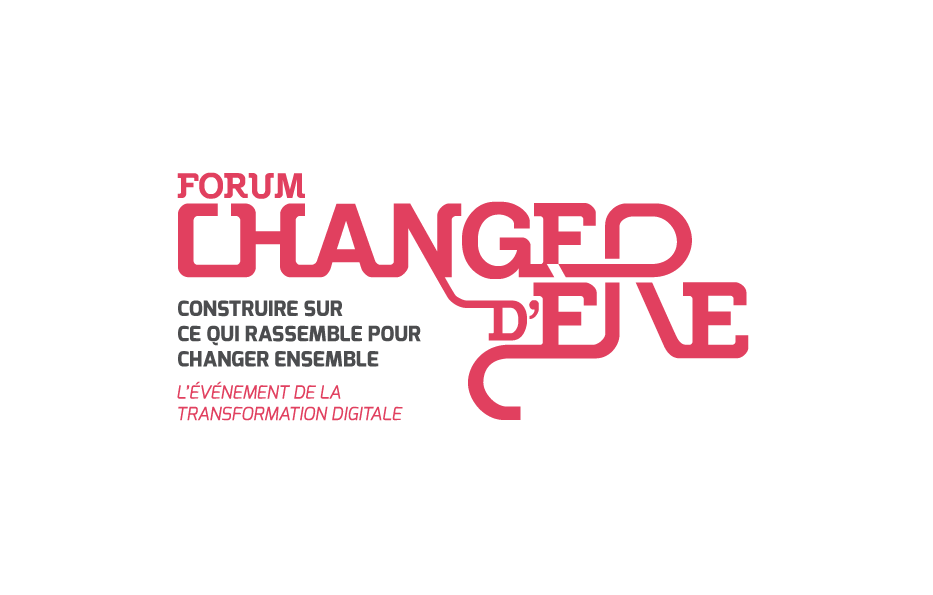Véronique Anger : Au cours des trois dernières décennies, l’Atelier a étudié -et encouragé- quelques « révolutions »: le Minitel, la micro-informatique et, plus proche de nous, l’Internet. Comment l’Atelier est-il devenu la cellule de veille technologique que nous connaissons aujourd’hui ?
Précurseur dès la fin des années 70, aujourd’hui reconnu et écouté en France comme à l’étranger, l’Atelier a acquis ses lettres de noblesse.
Pour son fondateur et Directeur, Jean-Michel Billaut*, cette cellule de veille technologique pas tout à fait comme les autres, va continuer à évoluer, mais : « la vocation de l’Atelier sera toujours d’essayer de comprendre « qui fait quoi » dans un paysage économique en perpétuel mouvement ».
Jean-Michel Billaut : A l’origine, nous nous réunissions entre collègues pour discuter de l’avenir de la micro-informatique, du traitement de textes,… En fait, l’Atelier est réellement devenu l’Atelier grâce au Minitel. A cette époque, nous étions une poignée à la Cie Bancaire à penser que ce nouvel outil révolutionnerait notre métier. N’étant pas l’oeuvre d’un grand constructeur tel qu’IBM, personne ou presque n’y croyait.
Soutenus par notre Président d’alors, nous avons aidé un certain nombre d’idées innovantes à voir le jour, en particulier le projet d’une de nos filiales qui utilisait le minitel pour saisir électroniquement des dossiers de crédit à la consommation.
La suite, vous la connaissez : nous avons réalisé des gains de productivité énormes et, grâce à l’avance technologique que nous avons prise sur nos concurrents, nous avons gagné près de 20% de parts de marché en deux ans ! Tout le commerce français a été obligé d’adopter le Minitel.
Dans le contexte de l’émergence de la micro-informatique, cet épisode a fini de convaincre notre Direction générale de l’intérêt des nouvelles technologies. Voilà comment l’Atelier est officiellement devenu la cellule de veille technologique de la Cie Bancaire puis, tout naturellement, est restée celle du groupe BNP/Paribas.
VA : Quels sont les grands axes de recherche de l’Atelier aujourd’hui ?
JMB : L’Atelier répond en fait à plusieurs objectifs. Nous essayons de comprendre et d’anticiper les bouleversements liés aux NTIC. Nous observons les technologies en perpétuelle évolution, mais également les nouvelles organisations de marchés qui voient le jour dans tous les secteurs d’activités humains.
Ignorer ou refuser de voir les changements dans nos métiers peut être lourd de conséquences. Nous organisons donc en permanence des séances de réflexion. Par exemple, nous suivons de très près une startup américaine, qui devrait étendre son activité à l’Europe d’ici à la fin de l’année. Cette société propose d’envoyer ou de recevoir de l’argent par email. Il suffit pour cela d’ouvrir un compte chez eux, de préciser le nom du bénéficiaire et le montant à débiter de votre carte de paiement. Le destinataire reçoit un message du type : « M. X vous a envoyé 100$, cliquez sur cette URL sécurisée et vous recevrez votre argent ». Si ce service est très séduisant pour les consommateurs, il l’est moins du point de vue des banquiers traditionnels !
Voilà une bonne illustration du style de préoccupations de l’Atelier : analyser la situation et réagir avant qu’il ne soit trop tard.
L’Atelier joue également un rôle de communication institutionnelle. C’est dans cet esprit que nous avons lancé, en 87, notre propre revue « Le Journal de l’Atelier », rebaptisé depuis « Le Journal de la NetEconomy » (12 000 abonnés). Nous donnons aussi de nombreuses conférences en France et à l’étranger, ce qui a contribué à donner à l’Atelier une certaine notoriété.
Nous avons ouvert nos portes au public dès les années 80. Au fil du temps, l’amphithéâtre de l’Atelier est devenu une sorte de forum ouvert où les cartes de visite s’échangent.
Par ailleurs, nous avons récemment créé une chaîne de télévision sur le Net, qui retransmet tous nos ateliers thématiques. Pour l’instant, l’audience reste assez confidentielle (250 télespectateurs par jour) car cette technique (le « streaming ») est encore peu connue en France.
Enfin, nous avons constitué une cellule de « Net Economistes » pour étudier les impacts des nouvelles technologies sur les métiers et les marchés quels qu’ils soient (du meuble, de la banque, de l’assurance, du pétrole,…). Dans la mesure où tous les secteurs d’activité sont concernés par la société de l’information, nous devons essayer d’avoir une vision globale du paysage technologique. Or, les choses bougent très vite. Les bouleversements sont encore plus importants que ceux provoqués par la révolution industrielle, car ils vont se produire sur seulement une ou deux générations. Dans ce contexte, comment digérer tous ces changements et s’y adapter ? C’est à cette question que nous devons répondre.
VA : Depuis l’invention du Web, l’Atelier semble mener, en parallèle de ses activités de veille, une sorte de croisade : faire prendre conscience aux gouvernants et aux décideurs que nous vivons une réelle révolution…
JMB : Notre culture Internet est trop neuve. Al Gore a lancé ses « autoroutes de l’information » en 92 ; le discours de Lionel Jospin sur les NTIC date seulement de 97… Le mouvement startup « gaulois » a démarré l’an dernier, alors qu’il existe depuis 5 ans outre Atlantique. Bref, nous avons toujours 5 ans de retard !
Nous essayons de sensibiliser les gouvernants aux enjeux des technologies Internet, mais les mentalités ne changent pas du jour au lendemain… Pourquoi les Etats-Unis ou les pays scandinaves mènent-ils des politiques visionnaires dans ce domaine, et pas la France ?
Ici, le streaming en est à ses balbutiements quand les US diffusent 400 000 heures de programmes nouveaux chaque semaine. Plus alarmant : seulement 15% des foyers français possèdent une connexion à Internet contre 50% aux Etats-Unis et 60% chez les Scandinaves. Je vous cite un autre exemple : la Suède a fait le choix de la fibre optique pour tous. Là-bas, les foyers peuvent se connecter à une vitesse de 10 Megabits pour 150 francs par mois. Et les Etats-Unis testent déjà leur projet Internet2 (à large bande) dans les Universités.
Nous avons les moyens de figurer parmi les acteurs principaux de la société de l’information, mais il nous manque encore une volonté forte.
VA : Quelle est la stratégie de l’Atelier pour les prochaines années ?
JMB : L’Atelier va continuer à évoluer. Sa vocation sera toujours d’essayer de comprendre « qui fait quoi » dans un paysage économique en perpétuel mouvement.
Les startups (on estime leur nombre à environ 100 000 dans le monde, dont la majorité pour les USA, moins d’un tiers pour l’Europe et quelques milliers pour Israël -toutes « incubées » dans l’armée- et quelques dizaines pour l’Asie du Sud-Est qui entre à son tour dans la ronde) nous secouent et nous obligent à nous poser des tas de questions.
Nous sommes en train de mettre au point un observatoire de startups. Notre objectif est de nous associer avec des partenaires non concurrents pour fonder une sorte de « fondation » mondiale de la Net economy. Nous aurons des relais (un réseau d’une cinquantaine de correspondants) dans le monde entier. Le monde devient village : de franco- français, nous allons essayer de passer au « village planétaire » !
VA : Quelle est votre analyse de la situation actuelle ?
JMB : Je dirais que l’Internet entre dans sa troisième phase. Après l’émergence en 95 des premières startups américaines (Amazon, Auto by Tel, E Trade, …) nous avons vécu, deux ou trois ans après, l’arrivée -à grands renforts de dollars- des « empereurs » (Fnac, Barns & Novels, …) contraints d’adopter le concept du « click & mortar » (« clic d’achat » en français) pour rester dans la course. Aujourd’hui, nous amorçons une nouvelle étape, qui voit les « empereurs » se livrer un combat sans merci.
L’Internet est beaucoup plus qu’un nouveau média, ou qu’une vaste place de marché. En permettant d’occuper le terrain des autres, il ouvre de nouveaux horizons : c’est un leader de la grande distribution ou de l’assurance qui ouvre sa banque, c’est France Télécom qui concurrence la Fnac (en rachetant Alapage.com) ; ou Darty (en prenant des parts dans Marcopoli). La « guerre des empereurs » conduit à un étonnant mélange des genres… Pour rester dans la course, les plus grands doivent élargir leur cœur de métier à de nouveaux domaines d’activité. C’est très déstabilisant, mais cela promet aussi d’être passionnant !
*Jean-Michel Billaut est également Vice-Président de l’Association Française pour le Commerce et les Echanges Electroniques (AFCEE).
Quand l’atelier veille…
Comments 0
- Les Di@logues Strategiques on 2 mai 2010 inLes Di@logues Strategiques
Non classé
(Les Di@logues Stratégiques® N°4 – 09/00)