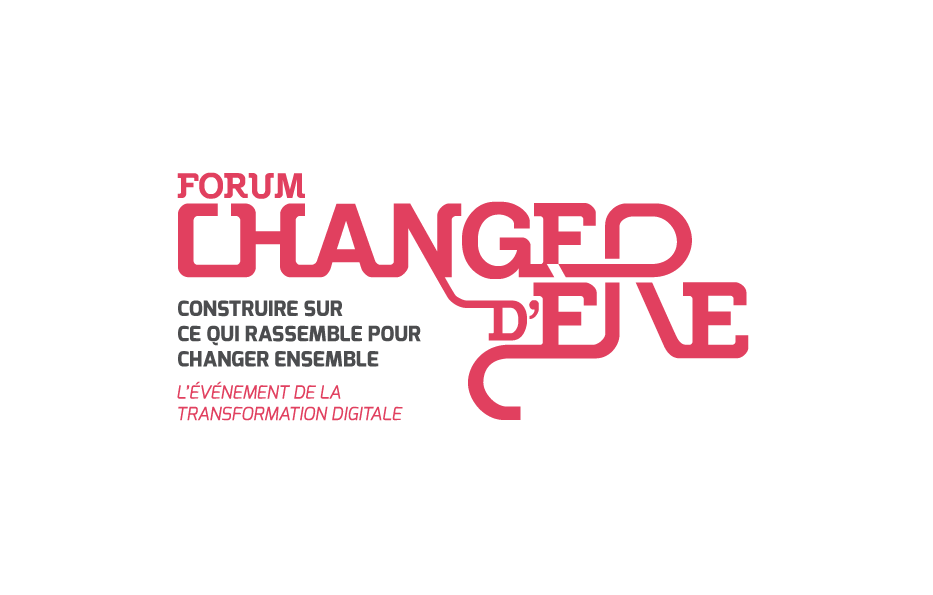Véronique Anger : Qui peut saisir la juridiction prud’hommale, et pour quels types de contentieux ? VA : Que se passe-t-il lorsqu’un salarié saisit la juridiction sur un problème de fond (contestation de la rupture du contrat de travail, par exemple) ? VA : Qu’est-ce qui fait la spécificité de la juridiction prud’hommale ? VA : Beaucoup d’employeurs reprochent aux conseils de prud’hommes de donner systématiquement raison aux salariés. VA : Les récentes élections prud »hommales n’ont pas réussi à mobiliser salariés et employeurs. Que pensez-vous de ce désintérêt pour cette juridiction ? VA : En dépit des dérives du système prud’hommal (tribunaux surchargés, procédures trop longues…) vous vous êtes spécialisée dans ce domaine. Qu’est-ce qui a motivé votre choix ? VA : Quel conseil donneriez-vous aux employeurs pour leur éviter les prud’hommes ? (1) Les conflits d’ordre collectif relevant du tribunal d’instance, de grande instance, correctionnel, administratif ou encore des juridictions de sécurité sociale.
« L’appréhension qui existait par le passé est de moins en moins présente. Désormais, les salariés n’hésitent plus à recourir à la juridiction prud’homale. De ce fait, les litiges sont de plus en plus nombreux et les Conseils de prud’hommes sont surchargés. ». Ce constat est de Maître Chrystelle Deschamps avocate, spécialisée en droit social.
Maître Chrystelle Deschamps : Tout salarié ou employeur, du secteur privé ou appartenant à des établissements publics industriels ou commerciaux, est en droit de saisir la juridiction prud’hommale, à titre individuel(1).
La majorité des affaires sont liées à la rupture du contrat de travail (licenciement personnel, économique,…) ou au règlement des rémunérations (salaire, primes, heures supplémentaires,…). Les autres contentieux concernent la modification du contrat de travail, les clauses de non concurrence et, de plus en plus fréquemment, la discrimination et le harcèlement (moral ou sexuel).
La jurisprudence est devenue draconienne vis-à-vis de l’employeur, en particulier en matière d’accidents du travail. La mise en cause de la responsabilité pénale du chef d’entreprise devient également de plus en plus courante et les contentieux abondent au tribunal des affaires de sécurité sociale ainsi qu’au tribunal correctionnel.
L’appréhension qui existait par le passé est de moins en moins présente. Désormais, les salariés n’hésitent plus à recourir à la juridiction prud’hommale. De ce fait, les litiges sont de plus en plus nombreux et les Conseils de prud’hommes(2) sont surchargés. Les délais moyens sont de deux ans pour obtenir un jugement(3) !
Maître Deschamps : La première étape a lieu devant le Bureau de Conciliation (en présence d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié). Le but est d’arriver à une médiation.
Dans la mesure où les avocats se sont déjà rapprochés sans parvenir à négocier un accord, cette audience de conciliation est, à mon sens, une perte de temps.
La deuxième étape se passe devant le bureau de jugement où l’affaire est plaidée devant un conseiller.
En l’absence d’accord, l’affaire sera renvoyée devant un tiers, le juge départiteur (un magistrat professionnel) qui devra départager les parties. Il est possible de faire appel de la décision, bien entendu.
Maître Deschamps : Elle est spécifique en ce sens qu’elle est au cœur du monde du travail. Comme vous le savez, elle n’est pas composée de magistrats professionnels, mais de salariés et d’employeurs élus par leurs pairs, tous les cinq ans et à part égale.
N’est-ce pas une manière de conjurer les dérives du passé ? La France traîne un passif assez lourd avec ses « charrettes » de licenciements économiques qui ont traumatisé la population dans les années 90…
Maître Deschamps : Il est reconnu que la cour de cassation et les cours d’appel statuent le plus souvent en faveur du salarié. Dans la mesure où le droit du travail français privilégie les intérêts des salariés, cela me semble assez logique… La Loi de modernisation sociale votée sous le précédent gouvernement, pour ne citer que cet exemple, n’a fait qu’alourdir les procédures de licenciement collectif dans un esprit de protection des salariés.
Ce phénomène est moins évident en première instance (aux prud’hommes) où vous pouvez obtenir une décision favorable à l’employeur.
Pour ce qui est des dérives du passé, je partage votre point de vue. Comme vous le rappelez, certains dirigeants de grands groupes ont exagéré, et les sanctions sont tombées.
Aujourd’hui, si l’employeur perd dans la majorité des cas, les condamnations sont beaucoup moins pénalisantes qu’à l’époque des grandes vagues de licenciements économiques. C’est un premier pas !
Maître Deschamps : Effectivement, la mobilisation(4) n’était pas au rendez-vous. Je pense que l’organisation du système est beaucoup trop compliquée.
De plus, à moins d’avoir eu affaire à la juridiction prud’hommale, les salariés en connaissent mal le fonctionnement.
Quoi qu’il en soit, abstention ne signifie pas forcément indifférence. La participation aux élections pourrait être plus importante si la communication était plus claire, et les procédures de vote plus simples.
Maître Deschamps : J’exerce cette profession depuis une douzaine d’années. C’est un choix délibéré car c’est une matière très vivante, avec une jurisprudence très importante et qui évolue constamment… même si l’interprétation des lois ne me semble pas toujours aller dans le bon sens !
Avant de me lancer en indépendante, j’ai fait mes armes dans de gros cabinets défendant principalement des employeurs et des cadres. Je continue dans le même esprit.
Je trouve, par ailleurs intéressant de défendre son dossier à corps et à cris… En effet, la plaidoirie joue un rôle déterminant. Et, quelle que soit l’issue, c’est toujours passionnant !
Maître Deschamps : Je leur conseillerais d’avoir un bon dossier s’ils envisagent de licencier. Hélas, beaucoup n’ont pas ce réflexe. Une règle de base : mieux vaut un départ négocié, avec des concessions réciproques, qu’un procès de plusieurs années aux prud’hommes.
(2) Le terme « prud’homme », qui trouve son origine au Moyen-Age, signifie « homme preux ». Le tribunal de prud’homme, sous sa forme moderne (depuis 1907) est devenue instance nationale par la loi du 18 janvier 1979.
(3) Ce délai peut être ramené à quelques mois si le plaignant a demandé un référé, la voie rapide pour les mesures urgentes et incontestables (paiement de salaire, de solde de tout compte…).
(4) Taux de participation 2002 : Salariés = 32,66% – Employeurs = 26,64% (respectivement 63% et 48% en 1979)
Prud’Hommes : des contentieux de plus en plus nombreux
Comments 0
- Les Di@logues Strategiques on 2 mai 2010 inLes Di@logues Strategiques
Non classé
(Les Di@logues Stratégiques® N°42 – 02/03)