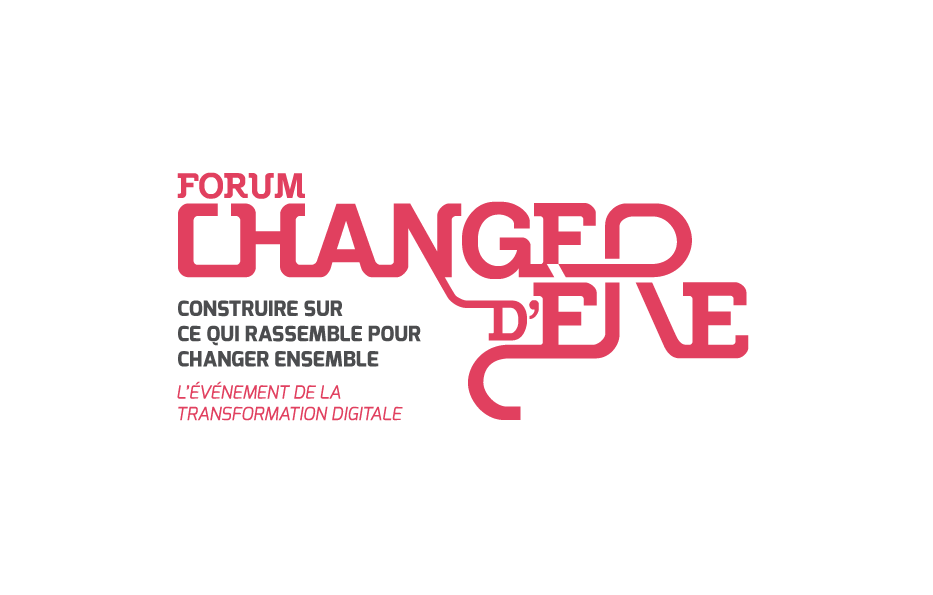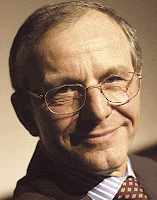Véronique Anger : A la lueur des nouvelles théories qui révolutionnent la biologie développées notamment dans « Ni dieu, ni gène, pour une autre théorie de l’hérédité » par les biologistes Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo***, quelle est votre vision du génome ? Selon vous, est-ce la fin de la génétique déterministe ?
Version Anglaise
Le Professeur Axel Kahn* est généticien, médecin, directeur du département de génétique, développement et pathologie moléculaire de l’Institut Cochin de génétique moléculaire.
Humaniste, scientifique engagé, membre du Comité consultatif national d’éthique français, Président du groupe des experts en Sciences de la vie auprès de la Commission européenne, Axel Kahn s’interroge et nous incite à réfléchir aux aspects éthiques liés aux grandes avancées scientifiques, en particulier génétiques.
Ses ouvrages de vulgarisation rencontrent beaucoup de succès auprès du grand public. Son dernier livre** « L’avenir n’est pas écrit » pose notamment le problème des excès de la science.
Professeur Axel Kahn : Déclarer que la génétique ne peut être entièrement déterministe est une évidence. Personnellement, je suis extrêmement opposé à la thèse du déterminisme ultra-génétique et à la thèse du « gène égoïste« (1) de Dawkins. Depuis la présentation par Darwin de la théorie de l’évolution, plusieurs exégèses et plusieurs » déviations » (ou évolutions) de la théorie darwiniste ont vu le jour. L’une d’entre elles va effectivement dans le sens d’un ultra-déterminisme génétique. Elle culmine à travers la théorie du gène égoïste de Richard Dawkins. Selon ce dernier, l’évolution ne fait que refléter la compétition qui existe entre les gènes en vue de leur propre promotion. Ainsi, les cellules seraient des mécanismes à amplification et donc à manifestation de la compétition entre les gènes.
La thèse de Kupiec et Sonigo revient à remplacer le gène égoïste par la « cellule égoïste » : les cellules entrent en compétition les unes avec les autres. Il n’existe pas de sélection au niveau des organismes eux-mêmes. Ceux-ci ne sont que la manifestation, au niveau élémentaire, d’une compétition égoïste entre les cellules.
En fait, la thèse de Kupiec va bien au-delà de ce qu’il y a d’exagéré et de non recevable dans la thèse du gène égoïste. Il propose une autre vision, parfaitement idéologique me semble-t-il, substituant au déterminisme uniquement génétique un déterminisme uniquement cellulaire. Selon cette approche, il n’existe donc pas de sélection entre les animaux, entre les organismes ; tout cela n’étant que la manifestation de l’égoïsme cellulaire. Pour vous expliquer à quel point ceci me semble exagéré, je vais vous donner un exemple. Lorsque deux organismes possèdent le même génome (comme chacun sait, c’est le cas de tous les jumeaux monozygotes) quels que soient l’indépendance cellulaire et le caractère aléatoire du développement embryonnaire, les organismes issus de ces deux embryons au génome identique sont de « vrais jumeaux », c’est-à-dire qu’ils se ressemblent. Vous voyez bien qu’il est impossible de faire de la biologie sans reconnaître également l’élément du déterminisme génétique…
Je pense que la vérité se situe entre les deux : il y a effectivement un déterminisme génétique : les gènes déterminent des protéines, et les protéines interviennent pour leur part dans les propriétés des cellules. Cela étant, ce déterminisme est lié à certaines des propriétés cellulaires, et rien ne s’oppose à ce qu’il existe également un élément de compétition de sociologie cellulaire, par exemple au cours de l’embryogenèse(2). En ce qui me concerne, je suis favorable à un retour à une conception darwinienne : la sélection s’effectue globalement entre les organismes. Les organismes connaissent un certain déterminisme, ainsi que des phénomènes de sociologie cellulaire. C’est ce qui fait la complexité de la biologie. Je pense qu’il y a quelque chose de théologique et d’excessif aussi bien dans la thèse du gène égoïste de Dawkins que dans celle de la cellule égoïste de Kupiec et de Sonigo.
VA : L’annonce, en novembre dernier, par le laboratoire ACT du Massachusetts, d’une expérience de clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques suscite la controverse. Au titre de membre du Comité consultatif d’éthique, mais aussi en tant qu’homme, quel est votre point de vue : doit-on bannir ou promouvoir ces pratiques ?
Pr AK : Cette annonce d’Advanced Cells Technology est de la foutaise… Il s’agit d’une annonce d’échec en réalité. Depuis dix ans, les expériences visant à obtenir des embryons clonés se succèdent. L’université St-Louis (USA) avait prétendument obtenu (par transfert de noyau) des embryons clonés au stade quatre cellules(3). Quelques temps après, ce sont des chercheurs coréens qui faisaient l’actualité. Cette fois, après dix années d’effort, ACT affirme avoir obtenu (au bout d’une soixantaine de tentatives) des embryons au stade six cellules. Ces embryons clonés ont cessé de se développer vingt quatre heures seulement après le début de la division(4). Cela prouve en réalité que personne ne sait encore cloner un embryon humain, ni même un embryon de primate. En effet, nous avions déjà noté ces difficultés chez les singes. Nous en ignorons toujours la nature et, à ce jour, nous sommes toujours incapables de les surmonter. Bien entendu, cela ne signifie nullement qu’on n’y parviendra pas un jour… Cela étant, d’un point de vue purement éthique, je suis totalement opposé -pour quelque raison que ce soit- à toute légitimation de la reproduction par clonage d’êtres humains.
Cette autorisation donnerait le droit -insensé- à certains individus d’en reproduire d’autres à leur image… Cette forme d’assujettissement des uns aux autres, ne serait-ce que dans le cas où celui-ci serait limité à l’enveloppe corporelle, me paraît insupportable. De quel droit quelqu’un pourrait-il déterminer le sexe, la couleur des yeux ou des cheveux, la forme du menton, ou tout autre caractéristique d’un être humain ? Je ne vois donc aucune raison de légitimer le clonage reproductif.
Pour ce qui est du clonage thérapeutique, un premier problème se pose : avant de réaliser un clonage soi-disant thérapeutique, il faut d’abord mettre au point la technique permettant d’obtenir un embryon humain cloné. Par ailleurs, lorsqu’on y regarde de plus près, le clonage thérapeutique n’a aucune crédibilité. Imaginez que je sois victime d’un infarctus du myocarde ou d’une maladie d’Alzheimer ou de Parkinson, par exemple. Je souhaite être traité par clonage thérapeutique. Que va-t-il se passer ? On commence par prélever un morceau de ma peau pour la mettre en culture. Ensuite, on essaie de se procurer sur le marché des centaines d’ovules. Naturellement, les conditions dans lesquelles on va les obtenir pose un souci éthique évident. Ne risque-t-on pas de favoriser le trafic d’ovules de femmes ?
Ensuite, on va devoir échanger les noyaux de ces ovules par les noyaux de mes cellules cutanées cultivées. Les résultats sont très aléatoires puisque nous ne maîtrisons pas encore cette technique. Admettons que l’on réussisse à obtenir un embryon que l’on va tenter de le développer jusqu’à six jours.
Enfin, on prélève quelques cellules pour les mettre en culture. Il faut maintenant leur commander de se transformer soit en cellules du cœur (pour soigner mon infarctus) soit de en cellules du cerveau (pour lutter contre ma maladie d’Alzheimer ou de Parkinson).
Cette démonstration illustre bien l’irréalisme d’un tel projet. J’aurai eu le temps de mourir cent fois avant que tous ces efforts aboutissent à une solution efficace !
En admettant que l’on y parvienne, par exemple pour une maladie chronique, il est clair que cette technique s’avère totalement narcissique, extraordinairement dispendieuse en temps, en efforts et en argent. De plus, ces médicaments (aux effets incertains) seraient réservés aux rares privilégiés suffisamment riches pour pouvoir s’attacher les services d’une pleine équipe de biologie pendant plusieurs mois… Outre les importantes objections morales, les indications médicales et un total irréalisme, je ne vois pas ce qui pourrait autoriser une recherche sur le clonage thérapeutique dans les laboratoires publics.
VA : Le séquençage du génome humain est pratiquement achevé. Dans votre dernier livre » L’avenir n’est pas écrit « , vous dites : » Dans ce domaine de recherche (passer de la séquence primaire des gènes à la compréhension de leurs fonctions) il reste encore au moins un siècle de travail. « . Devrons-nous réellement, compte tenu des progrès impressionnants de l’informatique, patienter tant d’années avant de comprendre la signification de l’alphabet génétique ? (Le séquençage a été réalisé beaucoup plus rapidement que prévu par exemple).
Pr AK : Quoi qu’en pensent certains, la meilleure métaphore du programme » génome » et du déterminisme génétique est un langage constitué d’un alphabet génétique (4 lettres au lieu de 26 dans l’alphabet latin). La plus petite réunion des lettres de notre alphabet possédant un sens forme un mot. La plus petite réunion des lettres génétiques ayant une signification individuelle est un gène. La signification d’un mot est totalement contextuelle : elle dépend bien de la phrase et de son contexte. La signification d’un gène l’est également ; elle est liée aux autres gènes et à leur environnement. Le niveau d’étude génétique auquel nous sommes parvenus aujourd’hui est le début de l’édification d’un dictionnaire, comprenant une suite de mots » gènes » associés à une première définition. Naturellement, lorsque vous disposez d’un dictionnaire, vous n’avez pas encore écrit » A la recherche du temps perdu de Proust « , les poèmes de René Char ou de Victor Hugo… Un « dictionnaire génétique » permet seulement de faire de la biologie ; il ne résume pas la biologie. Le séquençage du génome offre de nouvelles perspectives, de nouveaux moyens. C’est en ce sens que nous sommes seulement au début de l’histoire.
VA : Vous êtes Commissaire de l’exposition « L’homme et les gènes », présentée à la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette, à partir du mois de mai prochain. Cette exposition posera la question » des enjeux et des limites de la connaissance de l’homme par les sciences » (je vous cite). Quelles sont les grandes options de votre exposition ? Et, à quelles limites faites-vous allusion ?
Pr AK : Le thème de l’exposition « L’homme et les gènes » trouve son origine au cœur de ma propre réflexion. L’homme, produit de l’évolution, est poussière d’étoile, il est matière. La matière, qui s’est transformée en vie, a acquis la conscience. C’est l’apparition de l’homme. L’homme se prétend libre du fait des caractéristiques neurobiologiques et cognitives qu’il a acquises. La conscience de l’homme et ses capacités cognitives l’ont poussé à s’interroger sur son origine matérielle (l’origine en tant qu’avatar de l’évolution) et sur sa responsabilité. Nous nous trouvons donc face à un homme qui s’interroge et est capable d’engranger de nombreuses connaissances. Mais ces connaissances ne lui indiquent en rien -parce qu’il est libre- dans quel sens utiliser le pouvoir de ce savoir. La question de la responsabilité se situe au cœur de la réalité anthropologique de notre espèce. C’est exposition essaiera de tracer le chemin » de la matière à la vie et à la conscience « . Une conscience qui revient sur ses origines et met en lumière le problème de l’humain, c’est-à-dire la responsabilité d’un être libre d’utiliser ses pouvoirs au profit ou au détriment du monde et de l’homme.
(2) Embryogenèse ou embryogénie : formation et le développement d’un organisme animal ou végétal au stade de l’embryon à la naissance.
(3) En novembre dernier, Advanced Cells Technology, un laboratoire du Massachusetts, a annoncé avoir réussi le premier clonage humain en vue de produire des cellules souches destinées au traitement de maladies incurables. La technique de clonage employée est identique à celle utilisée par l’équipe de PPL Therapeutics pour créer la brebis Dolly en 97 (introduire le noyau d’une cellule prélevée sur un organisme adulte dans un ovocyte énucléé). Selon les biologistes de ACT, trois embryons se seraient ainsi développés jusqu’au stade 6 cellules. L’expérience visait à » cultiver » des cellules clonées afin de fabriquer des tissus humains susceptibles d’être transplantés sans risque de rejet (les tissus étant ceux du patient).
(4) L’embryon est défini comme l’organisme en voie de développement, depuis l’œuf ou zygote (résultant de la fécondation de l’ovule par le spermatozoïde) jusqu’à la forme capable de vie autonome. Chez l’homme, on appelle fœtus l’embryon de plus de trois mois.
**Axel Kahn, Docteur en médecine et Docteur ès sciences, est Directeur de recherche à l’INSERM et dirige l’INSTITUT COCHIN (INSERM U.567/UMR8104 CNRS). Ses travaux scientifiques portent notamment sur le contrôle des gènes, les maladies génétiques, le cancer et la nutrition. Ils ont donné lieu à environ 500 articles originaux publiés dans des revues scientifiques internationales avec comité de lecture, par exemple, Nature, Cell, Nature Genetics, Pr.Natl.Acad.Sci of USA …). Il a été Président de la Commission du Génie Biomoléculaire de 1987 à 1997, Rédacteur en chef de la revue Médecine Sciences de 1986 à 1998 et a été membre du Comité Consultatif National d’Ethique de 1992 à 2004. De 2000 à 2002, il a présidé à Bruxelles le Groupe des Experts de Haut Niveau en Sciences de la Vie auprès du Commissaire de la Recherche de la Commission Européenne.
Axel Kahn est Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier du Mérite Agricole et Chevalier des Arts et des Lettres.
Expert reconnu dans le monde entier, le Professeur Axel Kahn a écrit des centaines d’articles d’information scientifique dans la presse spécialisée et généraliste. Il est également l’auteur de : » Comme deux frères » (avec Jean-François Kahn Stock. 2006) ; « Le secret de la salamandre » (avec Fabrice Papillon. Nil Eds. 2005) ; « Raisonnable et humain » (Nil Eds. 2004) ; » Et l’homme dans tout ça ? Plaidoyer pour un humanisme moderne » (avec Albert Jacquard. Nil Eds. 2000) ; » Copies conformes. Le clonage en question » (avec Fabrice Papillon. Nil Eds. 1998) ; » La médecine du XXIème siècle. Des gènes et des hommes » (Bayard. 1996)…
**Dans » L’avenir n’est pas écrit » (Bayard. 2001) le journaliste Fabrice Papillon anime le débat entre le Pr Axel Kahn et Albert Jacquard autour des grandes questions éthiques, philosophiques, scientifiques, de notre temps.
***Lire l’interview de Jean-Jacques Kupiec, avec le physicien Bertrand Laforge
Recherche fondamentale : le gouvernement fait fausse route (signé Yves Coppens, Gérard Fussman, Axel Kahn, Jean-Claude Pecker, Gabriele Veneziano, Jean-Pierre Vernant, Hubert Reeves. Le Monde du 04.04.05)
Pour en savoir plus :
A propos du génome humain : http://www.genoscope.cns.fr/externe/Francais/Questions/
Au sujet du « gène égoïste » : http://www.admiroutes.asso.fr/larevue/2000/4/mondememe.htm
« L’homme et les gènes » à la Cité des Sciences : http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/homgen/index.htm
Voir aussi : http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/encyclobio/index.html
: « Clonage et transfert de noyau : des connaissances à bien distinguer » Conférence de Henri Atlan
Et l’Université de tous les savoirs : http://www.canal-u.education.fr et http://www.lacinquieme.fr/concepts/W00081/7/26386.cfm
Institut Cochin
Professeur Axel Kahn : « L’avenir n’est pas écrit »…
Comments 0
- Les Di@logues Strategiques on 2 mai 2010 inLes Di@logues Strategiques
Non classé
Les Di@logues Stratégiques (01/02)
(1) Dans » Le gène égoïste » (78) le sociobiologiste anglais Richard Dawkins propose une nouvelle lecture de la compétition darwinienne. Selon son hypothèse, celle-ci ne s’exerce pas au niveau des espèces ou des organismes, mais à l’échelle des molécules d’ARN et d’ADN, qui constituent les gènes. En termes simplifiés, les gènes luttent entre eux à travers les organismes, n’hésitant pas à sacrifier tel organisme pour assurer leur survie si la sélection l’exige. Depuis, Dawkins a expliqué dans » Les mystères de l’arc-en-ciel « , que les gènes (à l’exception des bactéries et des virus) travaillaient égoïstement bien que » collectivement » à leur propre survie, au sein de l’environnement complexe du génome.